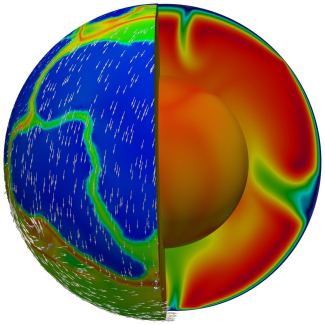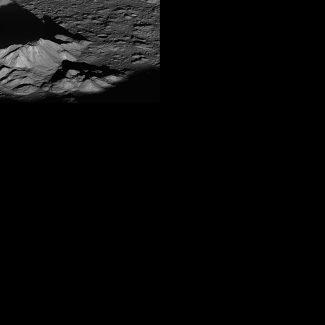Création d'un laboratoire franco-chilien de sismologie pour étudier les séismes de subduction
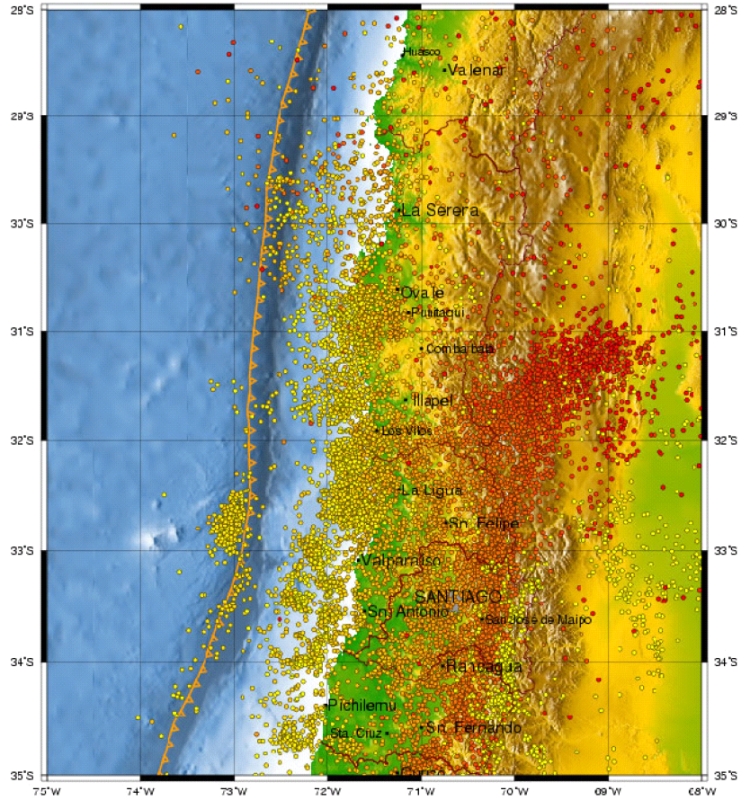
Le colloque qui se tiendra du 6 au 8 novembre 2006 à Santiago du Chili, organisé conjointement par les sismologues français et chiliens, célèbrera la mémoire du séisme de Valparaiso de 1906 et de Ferdinand Montessus de Ballore, ingénieur français qui installa le premier réseau sismologique du Chili. Il sera l'occasion de signer la convention de création(1) du Laboratoire International Associé (LIA) « Montessus de Ballore » qui associe le CNRS, l'INSU, l'IPGP, l'ENS et l'Universidad de Chile.
En 1906, trois grands séismes secouaient la côte pacifique américaine, le 31 janvier en Colombie-Equateur, le 18 avril à San Francisco, et le 16 août à Valparaíso. Dans les trois cas, les villes furent détruites et il y eut un nombre important de victimes. Le Chili, l'un des pays les plus sismiques au monde, décida alors de confier au polytechnicien français, Fernand de Montessus de Ballore, l'installation d'un réseau de stations sismologiques qui fut régulièrement modernisé et fonctionne toujours. Ferdinand Montessus de Ballore vécu et travailla au Chili jusqu'à sa mort. Depuis cette époque, le Chili a maintenu des relations étroites en sismologie avec la France et l'Europe.
Les recherches sur les sources sismiques et les processus de subduction ont fourni beaucoup d'informations sur les mécanismes de la génération des tremblements de terre, cependant ces derniers échappent encore à la possibilité de prédiction précise. La conférence fera le point sur les dernières avancées, liées essentiellement à des mesures de plus en plus précises de la déformation de la croûte terrestre.
L'ambition du nouveau laboratoire franco-chilien est de franchir une nouvelle étape dans plusieurs domaines : l'observation et la modélisation des processus associés à la genèse et à la dynamique des tremblements de terre de subduction ; la prédiction et la prévention du risque associé au grandes zones de subduction; la détection des tremblements de terre pouvant générer des tsunamis ; la compréhension du fonctionnement de ces grandes zones de subduction.
Le LIA se focalisera sur les deux régions cibles qui ont déjà fait l'objet d'un effort continu d'instrumentation de la part des équipes franco-chiliennes : la région Nord-Chili, avec la lacune de Tarapacá ; la région Central-Chili, avec les lacunes de Coquimbo au Nord et de Constitución-Concepción au Sud, et entre les deux, la région métropolitaine de Santiago. L'enjeu est de capturer un grand tremblement de terre de subduction dans ces régions et d'en étudier la préparation et la relaxation. Ces trois lacunes sismiques majeures, proches de la rupture (donc d'un séisme majeur), dont deux n'ont enregistré aucun séisme important depuis le XIXième siècle ont été indentifiées par ces équipes depuis une dizaine d'années.
Historique
Sur les traces de Montessus de Ballore, les équipes françaises ont donc une longue histoire de collaboration scientifique avec les équipes chiliennes des Départements de Géophysique (DGF) et de Géologie de l'Universidad de Chile de Santiago. Depuis plus de 15 ans, et avec le soutien du CNRS/INSU, du Ministère des Affaires Etrangères et de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT) au Chili, elles ont fortement collaboré avec le Département de Géophysique, au travers de nombreuses campagnes de terrain en sismologie, géodésie et tectonique. Elles ont, en particulier installé deux stations sismologiques du réseau GEOSCOPE et des réseaux permanent de stations GPS. Elles ont à leur actif des publications conjointes ainsi que la formation de jeunes chercheurs.
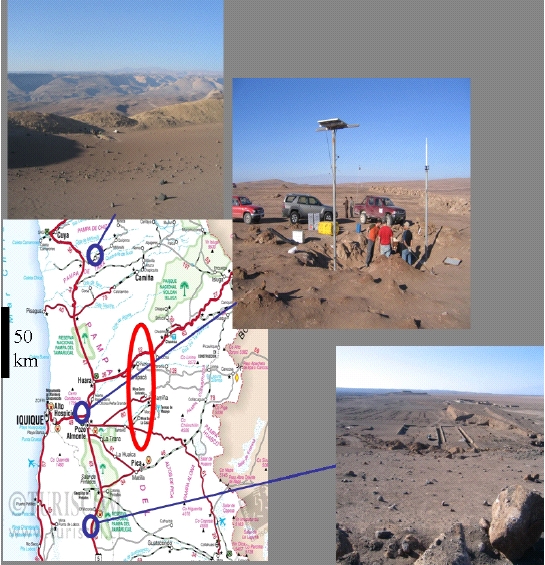
Les efforts français au Chili se sont construits au travers de nombreux projets soutenus tour à tour par des programmes de l'Union Européenne (ECOS-Sud) ; du CNRS/INSU (Lithoscope puis Dynamique et Evolution de la Terre Interne (DyETI)) ; du CNRS/DREI (Programme International de Coopération Scientifique (PICS)) et de l'Action Concertée Initiative (ACI) Prévention des Catastrophes Naturelles (CATNAT) pour la partie française et par la CONICYT pour la partie chilienne. Plus récemment, un programme de recherche d'une nouvelle ampleur, soutenu par l'Agence Nationale pour la Recherche (ANR) et coordonné par l'ENS et l'IPGP, a débuté pour étudier et capturer la genèse d'un grand séisme de subduction dans l'une de ces lacunes. Dans le même temps, une collaboration ambitieuse entre le GeoForschungsZentrum (GFZ Potsdam Allemagne) et le CNRS/INSU a permis l'installation d'un réseau permanent de stations large-bande et GPS télémétrées au Nord Chili.
La détection des déformations pré-, co- et post-sismiques des séismes d'Antofagasta (juillet 1995) et d'Arequipa (Pérou, janvier 2001), l'analyse du séisme de Punitaqui (octobre 1997) et des essaims sismiques de la lacune de Coquimbo sont les premiers fruits de cette longue collaboration. A la suite du séisme de Tarapacá (2005) dans la lacune du Nord Chili, localisé sous le réseau GPS permanent installé par l'IPGP, l'IRD et le DGF, le déploiement d'un réseau sismologique temporaire, lors d'une rapide intervention post-sismique coordonnée entre l'IPGP et le Departamento de Geofísica (DGF) de la Universidad de Chile, a permis pour la première fois de contraindre le mécanisme de ce séisme intraplaques et d'enregistrer encore aujourd'hui une activité sismique soutenue.