La faille de Fuyun (Chine), une faille qui a produit cinq séismes similaires
A partir des images du satellite Quickbird, des chercheurs de l'IPGP (1) et de l'EOS de Singapour (2), ont pu identifier dans le paysage aride du nord de la Chine, les marques laissées par cinq séismes anciens produits par le glissement brusque de la faille du Fuyun. C'est la première fois, qu'il est ainsi possible de remonter si loin dans le fonctionnement d'une telle faille. Ces données révèlent une régularité peu commune puisque les séismes consécutifs identifiés présentent les mêmes caractéristiques. De quoi affiner les modèles. Cette étude vient de paraître dans la revue Nature Geoscience.
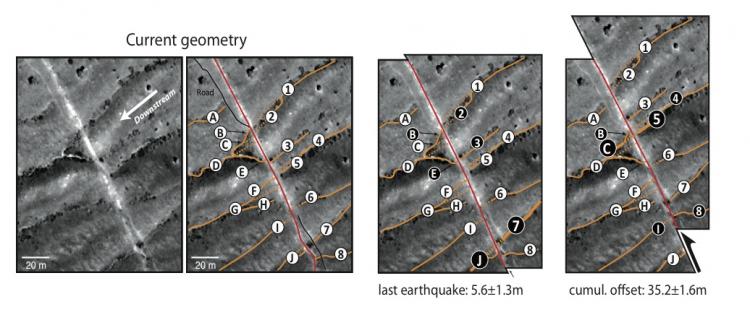
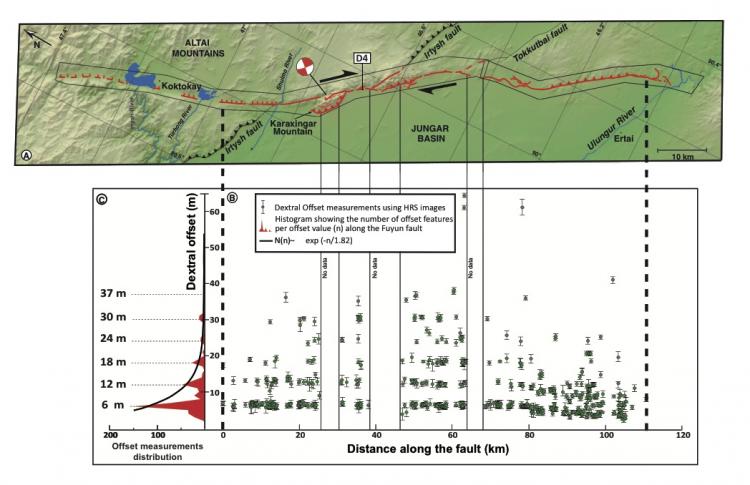
Sous l'effet de la tectonique des plaques, la croûte continentale se déforme. Cette déformation est accommodée en grande partie lors de séismes qui se produisent sur les failles actives. Parmi ces failles, on peut notamment identifier les grandes failles continentales décrochantes asiatiques qui permettent l'extrusion du Tibet et la déformation du bloc mongol, sous l'effet de la collision entre l'Eurasie et la plaque indienne. La manière dont ces failles accommodent la déformation associée à la tectonique des plaques lors de grands séismes est encore mal comprise. Les failles produisent-elles, ou non, toujours des séismes de même magnitude, et à intervalles de temps réguliers ? Le taux de déformation est-il constant au cours du temps? Ce sont autant de questions qui restent sans réelle réponse à ce jour. L'obstacle majeur pour espérer y répondre est la quasi-absence de longues séries temporelles de séismes observables sur ces failles. De ce fait, plusieurs modèles concurrents, peu contraints par les observations, tentent de décrire l'activité sismique des grands décrochements et la déformation de la lithosphère.
Identifier des sites d'études où l'on peut dater plus de 2 ou 3 séismes anciens successifs reste difficile. Les sites où il a été, de plus, possible d'évaluer la déformation associée à chacun de ces séismes sont encore plus rares. Dans ce travail, les auteurs ont tiré parti de l'imagerie satellitaire à très haute résolution (pixel de 60cm de coté) du satellite Quickbird, disponible depuis peu pour la recherche civile, pour étudier la rupture sismique associée au séisme de Ms 7.9 survenu en 1931 le long de la faille du Fuyun, au sud du massif de l'Altaï, à la frontière entre la Chine et la Mongolie. Les chercheurs ont pu acquérir* une bande d'imagerie de 5km de large et de 160km de long, qui couvre la majeure partie de la rupture de surface associée à ce séisme. C'est la première fois que ce type de données est utilisé pour imager un séisme ancien.
Les conditions climatiques particulièrement arides de cette région ont préservé la trace de la rupture de surface associée au séisme de 1931, mais aussi celles de séismes plus anciens. Ainsi, les chercheurs ont pu aussi bien les voir dans le paysage que les cartographier avec précision sur les images satellites. Grâce à de très nombreux marqueurs (290 mesures indépendantes) ils ont quantifié la déformation associée au séisme de 1931 et montré que le glissement qui lui est dû est en moyenne de 6.3m, tout au long des 120km de la rupture. Le fait que le glissement soit relativement constant le long de la rupture, contrairement à ce qui s'est produit lors d'autres séismes, est une observation importante qui reste encore mal comprise.
Un grand nombre de marqueurs (279 mesures) témoignent de déplacements cumulés au cours du temps provoqués par 4 grands séismes successifs qui pré-datent le séisme de 1931. Pour chacun d'eux, la distribution de glissement est similaire (6.24m ) à la celle du séisme de 1931. Ainsi, dans le cas de la faille de Fuyun, le fait que le glissement soit quasiment identique d'un séisme à l'autre apporte une observation clef qui accrédite l'hypothèse que cette faille suit un comportement de type « séisme caractéristique ». Ceci est en soit une contribution importante à la réflexion des spécialistes sur la répétition des grands séismes continentaux.
Pour tester plus avant cette hypothèse les auteurs ont proposé un modèle qui associe à chaque point de mesure le nombre de séismes qu'il a enregistré. Ce modèle décrit comment le paysage intègre l'ensemble des facteurs contribuant à la préservation, ou la destruction, des marqueurs géomorphologiques enregistrant les déplacements co-sismique. Il conduit à déterminer le « taux de préservation du paysage ». Ce taux correspond à une quantification globale des processus qui affectent le paysage. Il dépend très probablement des conditions climatiques locales et du temps de retour des séismes. Sa calibration précise, en datant de façon absolue les marqueurs géomorphologiques le long de la faille du Fuyun (datation qui est en cours), devrait servir de proxy du temps, non seulement dans la région de Fuyun mais aussi dans toute région présentant des caractéristiques climatiques proches. On peut, notamment, espérer établir le temps de retour des séismes, qui reste inconnu à ce jour sur la faille du Fuyun.
Sources
Characteristic slip for five great earthquakesalong the Fuyun fault in China
Y. Klinger(1), M. Etchebes(1), P. Tapponnier(2) and C. Narteau(1).
Nature Geoscience 2011, publié en ligne le 22 Mai.
- Institut de Physique du Globe de Paris (CNRS-INSU, Univ Paris Diderot, Cité Paris Sorbonne)
- EOS, Nanyang Technological University, Singapour
Notes
*Grâce à un soutien du CNES, dans le cadre de la préparation de la mission Pléiade.
![Première image à gauche : zone étudiée, le trait blanc oblique est la trace de la faille, on observe de part et d'autre les différents marqueurs du paysage.
Deuxième image : le trait rouge oblique est la trace de la faille, on observe de part et d'autre les différents marqueurs du paysage repérés (crêtes en orange, points singuliers numérotés).Troisième image : décalage dû au séisme de 1931. Quatrième image : décalage cumulé dû aux cinq derniers séismes.
© Klinger et al. 2011[...] Première image à gauche : zone étudiée, le trait blanc oblique est la trace de la faille, on observe de part et d'autre les différents marqueurs du paysage.
Deuxième image : le trait rouge oblique est la trace de la faille, on observe de part et d'autre les différents marqueurs du paysage repérés (crêtes en orange, points singuliers numérotés).Troisième image : décalage dû au séisme de 1931. Quatrième image : décalage cumulé dû aux cinq derniers séismes.
© Klinger et al. 2011[...]](/sites/institut_insu/files/styles/top_left/public/gallery_image/b4460.jpg?itok=s7RiPjK4)