Retour des campagnes australes 2007-2008
- De l'élévation du niveau des mers
par Laurent Testut, physicien-adjoint au Laboratoire d'études en géophysique et océanographie spatiales (LEGOS, CNRS / Université Toulouse 3 / CNES / IRD). - Les îles subantarctiques : des lieux privilégiés pour étudier les invasions biologiques et l'effet des changements climatiques
par Marc Lebouvier, ingénieur de recherche CNRS au sein de l'Unité "Écosystèmes, biodiversité, évolution" (ECOBIO, CNRS / Université Rennes 1). - Les aérosols dans l'océan Austral : enjeux scientifiques, caractérisation et tendances
par Roland Sarda-Estève, ingénieur-chercheur CEA au Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement (LSCE-IPSL, CNRS / CEA / Université de Versailles Saint Quentin. - Comment l'océan Austral régule-t-il la machine climatique ?
par Sabrina Speich, enseignant-chercheur au Laboratoire de physique des océans (LPO, CNRS / IRD / Ifremer / Université de Bretagne occidentale).
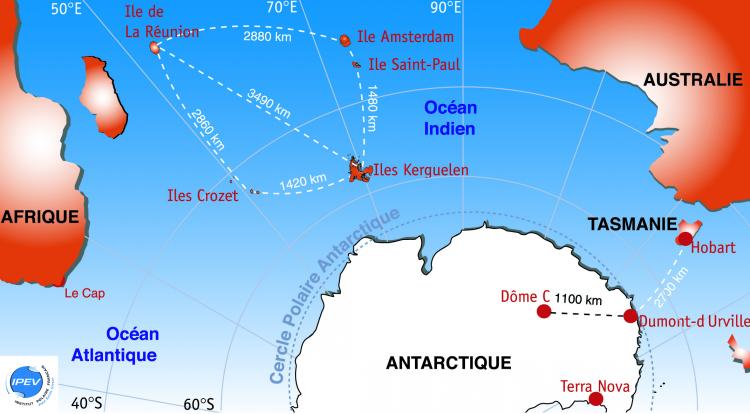
Les îles subantarctiques françaises comprennent les îles Saint-Paul et Amsterdam ainsi que les archipels de Kerguelen et de Crozet. Des bases scientifiques existent sur ces 3 archipels, la plus ancienne est celle de "Port-aux-français" à Kerguelen (1949).En Antarctique, la France dispose de 2 bases scientifiques permanentes : la base Dumont-d'Urville implantée en 1955 sur la côte et la base franco-italienne Concordia située à l'intérieur du continent où le premier hivernage a eu lieu en 2005.
Depuis plus d'un siècle, les chercheurs observent une élévation du niveau moyen des océans de l'ordre de quelques mm/an(1), sachant que cette vitesse a été plus rapide lors des 10 dernières années avec 3,1 mm/an. De plus, en relation avec le réchauffement attendu de notre planète, un scénario "raisonnable" conduit à prédire une élévation moyenne du niveau des océans de l'ordre de 50 cm en 2100, qui pourrait provoquer des changements considérables pour l'humanité (inondations, disparition de certaines zones côtières...). D'où l'importance de réaliser des enregistrements continus, précis et indépendants du niveau des mers en plusieurs points du globe. C'est pourquoi le programme international GLOSS a été mis en place. Il réunit plusieurs centaines de stations marégraphiques(2) de par le monde.
L'océan chauffe et les glaciers fondent...
L'accroissement des températures moyennes mondiales de l'atmosphère et de l'océan et la fonte quasi généralisée de la neige et de la glace sont en grande partie responsables de l'élévation du niveau moyen mondial de la mer. Celle-ci est causée par plusieurs facteurs : la dilatation thermique de l'eau de mer (augmentation du volume de l'eau sous l'effet de l'augmentation de la température), le déclin des glaciers de montagne et de la couverture neigeuse observé dans les deux hémisphères, la fonte d'une partie de l'Antarctique et du Groenland (amincissement, réduction ou bien perte de plates-formes glaciaires...).
ROSAME, un service d'observation du niveau des mers en terres australes
Soutenu par l'IPEV, ROSAME est un réseau de marégraphes de l'INSU-CNRS. Il comprend quatre stations marégraphiques côtières australes françaises (Dumont d'Urville, Saint-Paul, Kerguelen et Crozet) qui font partie du réseau de surveillance GLOSS.
Son principal objectif est de permettre de détecter, à long terme (sur plus de 10 ans) et de manière fiable, la tendance et les variations séculaires du niveau de la mer pour les hautes latitudes Sud. Il s'agit ensuite de mettre en relation ces données avec d'autres indicateurs climatiques (étendue des glaces de mer, bilan de masse des calottes, variations des paramètres thermodynamiques de l'océan).
Ce réseau cherche également à homologuer les observations satellitaires (ERS/ENVISAT, TOPEX/POSEIDON et JASON1). Ces données permettent de contrôler la validité des mesures altimétriques dans cette région de l'océan où les sites de comparaison sont quasi inexistants.
Un troisième objectif porte sur l'utilisation des données déjà recueillies pour valider les modèles hydrodynamiques de marée développés par l'équipe du LEGOS.
API : deux missions pour retracer l'évolution passée du niveau des mers
Au cours de l'Année polaire internationale, l'accent a été mis sur la recherche de données historiques du niveau de la mer. Pour cela, deux missions ont eu lieu dans les Terres australes et antarctiques françaises : l'une à l'île Saint-Paul à proximité des îles Kerguelen et l'autre en Terre Adélie, le long de la côte Antarctique. Elles visaient à retrouver les traces de niveaux moyens observés lors du passage de Venus devant le Soleil en 1874 (pour l'île Saint-Paul) et lors de l'expédition de l'explorateur australien Douglas Mawson en Terre Adélie en 1912. Les résultats obtenus permettront de combler en partie les lacunes relatives à l'élévation du niveau de la mer dans cette partie du globe.
Note(s)
- Estimation basée sur l'analyse des observations marégraphiques archivées depuis plus d'un siècle.
- Le marégraphe est un instrument qui enregistre les variations du niveau de la mer.
Les invasions biologiques sont considérées aujourd'hui comme la deuxième cause mondiale de l'érosion de la biodiversité, après la destruction des habitats. Les milieux insulaires sont beaucoup plus vulnérables à ces invasions que les continents, en raison de leur isolement, de leur surface réduite et du faible nombre d'espèces qu'ils hébergent (certains groupes biologiques, comme les grands prédateurs ou les grands herbivores, étant souvent absents). Ces caractéristiques, auxquelles s'ajoutent les contraintes climatiques, sont poussées à l'extrême dans les îles subantarctiques qui sont donc des lieux privilégiés pour étudier les invasions biologiques et leurs conséquences sur la biodiversité et le fonctionnement des écosystèmes.
L'impact des activités humaines et des changements climatiques sur la biodiversité
C'est pour mieux appréhender ces phénomènes que le programme de recherche "Changements climatiques, actions anthropiques et biodiversité des écosystèmes terrestres subantarctiques" a été initié au milieu des années 70 dans l'archipel Crozet et les îles Kerguelen (sud de l'océan Indien). Soutenu par l'IPEV, il est actuellement coordonné par Marc Lebouvier, ingénieur de recherche CNRS au laboratoire "Écosystèmes, biodiversité, évolution".
Ses objectifs ? Étudier la réponse des plantes et invertébrés aux contraintes environnementales, analyser les mécanismes d'invasion des espèces introduites (volontairement ou accidentellement) et préciser leurs relations avec les espèces locales.
Des envahisseurs qui menacent la biodiversité
À côté d'envahisseurs aux effets spectaculaires, tels le rat, le lapin ou le chat, les plantes et les insectes sont aussi concernés. Souvent plus discrets, ils peuvent néanmoins entraîner des bouleversements considérables dans les écosystèmes et une perte substantielle de biodiversité. Ainsi, un carabe (petit insecte coléoptère) introduit à Kerguelen depuis les îles Falkland au début du XXe siècle connaît depuis une dizaine d'années une expansion très importante. Dans certains secteurs de l'archipel, ce prédateur élimine progressivement la majorité des autres invertébrés, parmi lesquels les "mouches sans ailes de Kerguelen" qui jouent un rôle clé dans les écosystèmes par leur participation à la dégradation de la matière organique.
Un environnement plus chaud peut faciliter le développement des espèces étrangères
L'Antarctique n'est pas immunisé contre les espèces envahissantes, même si jusque là les impacts sont surtout concentrés dans les îles subantarctiques. Les changements climatiques en cours, très sensibles sous ces hautes latitudes, sont susceptibles de favoriser l'installation et l'expansion d'espèces envahissantes introduites, au détriment des espèces locales.
En outre, de plus en plus de personnes se rendent sur le continent austral. Il importe donc de mieux connaître les modes de colonisation afin de proposer des mesures visant à limiter les introductions dans ces écosystèmes originaux et très fragiles. C'est pourquoi Marc Lebouvier et son équipe ont participé au programme API Aliens in Antarctica sur les flux d'espèces introduites vers les îles subantarctiques en liaison avec la fréquentation humaine (inspection des équipements personnels des passagers à bord du Marion Dufresne et des vivres frais livrés sur les bases subantarctiques). De novembre à décembre 2007, à bord des bateaux et avions se rendant vers l'Antarctique, des chercheurs ont ainsi prélevé des échantillons afin de fournir une estimation du nombre de spores, graines, invertébrés, oeufs... amenés par l'homme. Une première du genre pour cette opération de grande ampleur qui implique une vingtaine de nations !
Cette problématique des espèces envahissantes se pose dans toutes les régions du monde, notamment dans les collectivités d'outre-mer qui abritent une biodiversité exceptionnelle mais particulièrement menacée. Il faut savoir qu'avec ces territoires, la France figure parmi les dix pays au monde hébergeant le plus grand nombre d'espèces animales et végétales susceptibles de disparaître. Marc Lebouvier et ses collègues ont ainsi participé à la rédaction d'une synthèse (à paraître en juillet), du comité français de l'UICN(1) sur les espèces exotiques envahissantes dans les collectivités d'outre-mer.
Note :
- Union mondiale pour la nature
Contact
- Marc Lebouvier, Ecosystèmes, biodiversité, évolution (ECOBIO) marc.lebouvier@univ-rennes1.fr, 02 99 61 81 75
L'océan Austral concentre un grand nombre de sources d'aérosols marins et continentaux. Ces particules(1) sont principalement des sels de mer, des aérosols soufrés, des poussières désertiques, des aérosols de combustion provenant de l'utilisation de fuels fossile ou bien des feux de brousse ou de savane. Les caractériser et évaluer leurs impacts climatiques dans cette région isolée du globe s'avère primordial à bien des égards.
L'océan Austral : un émetteur considérable d'aérosols naturels
Les conditions climatiques particulières à cette région (fréquence et intensité des vents) font de l'océan Austral l'une des premières sources au monde de sels de mer (embruns) dans l'atmosphère. Il est également le siège d'une production biogénique marine (plancton) très importante qui engendre des émissions de composés soufrés climatiquement actifs dans l'atmosphère (Diméthylsulfide océanique ou DMS(2)).
Compte tenu du réchauffement climatique actuel, l'étude de ces aérosols naturels est un enjeu scientifique majeur. L'équipe "Aérosol - Chimie" du Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement (LSCE) s'y intéresse depuis près de 20 ans, cherchant à déterminer les variations et les tendances de chacune des sources d'aérosols de l'océan Austral. Pour cela, les chercheurs utilisent les observations effectuées dans les stations atmosphériques des îles Crozet et Amsterdam. Celles-ci sont intégrées dans les bases de données des réseaux nationaux (ORE(3)) et internationaux (réseau météorologique mondial WMO-GAW, réseau AERONET de la NASA...). Elles servent également de contrainte pour les modèles climatiques.
AEROTRACE : un programme de recherche pour observer les aérosols dans l'océan Austral

Les mesures sont ensuite complétées par celles effectuées sur des nouveaux capteurs (sol/colonne atmosphérique/satellites). Grâce à cet ensemble de mesures, les chercheurs entendent mieux rendre compte du rôle de chacune des sources d'aérosols dans le forçage radiatif(6) direct et indirect de ces particules. Surtout, en renouvelant cette démarche, ils espèrent mieux appréhender l'évolution future de ces sources et leur influence potentielle sur le climat de l'océan Austral.
Note(s)
- Solides ou liquides, les aérosols sont des particules en suspension dans l'air
- C'est la principale source naturelle de soufre dans l'atmosphère. Les aérosols dérivés du DMS jouent un rôle important dans la microphysiologie des nuages, les précipitations, les nuages, entre autres.
- Observatoires de recherche en environnement
- AEROTRACE est un programme IPEV débuté en 2003 et piloté par Jean Sciare, chercheur CNRS au LSCE.
- Les missions exploratoires AEROBIPOLAR effectuées au Spitsberg en Arctique poursuivent également ces objectifs.
- Le forçage radiatif est défini comme la modification des entrées et sorties naturelles de chaleur, qui résulte de la présence d'aérosols et de polluants introduits par les activités humaines actuelles. Celui dû au dioxyde de carbone seul a augmenté de 20 % en 10 ans, de 1995 à 2005.
Contact
- Roland Sarda-Estève, LSCE/IPSL
roland.sarda-esteve@lsce.ipsl.fr
- Jean Sciare, LSCE/IPSL
jean.sciare@lsce.ipsl.fr, 01 69 08 24 01
Les océans, qui couvrent plus de 70% de la surface de la terre, jouent un rôle fondamental et complexe dans la régulation du climat terrestre. Grâce au programme océanographique Bonus-Goodhope, les chercheurs espèrent mieux cerner le rôle de l'océan Austral dans cette régulation.
L'océan Austral, un point stratégique du climat mondial
L'importance de cette région et son rôle dans la circulation océanique globale sont indéniables. L'océan possède une immense inertie thermique, autrement dit la capacité à accumuler puis à distribuer la chaleur sur toute la planète. Son efficacité dans la régulation climatique est, elle, fortement dépendante de la nature des échanges d'eau entre les bassins océaniques. De plus, du fait de sa forme annulaire, l'océan Austral constitue la principale voie d'intercommunication entre ces différents océans. Il permet aux eaux de circuler entre deux bassins, tout en les exposant à des conditions climatiques extrêmes. Ce qui génère, entre l'eau et l'air, de très importants échanges de chaleur, d'eau douce, de dioxyde de carbone et d'autres éléments chimiques. S'ensuivent des modifications notables dans les caractéristiques des masses d'eau qui transitent par l'océan Austral vers les autres régions océaniques. Tous ces échanges ont donc un impact sur la circulation océanique à l'échelle globale, sur les écosystèmes marins et de ce fait sur la stabilité de notre climat. Et, toute anomalie de température, de salinité ou de débit pourrait affecter cet équilibre au niveau mondial.
L'océan Austral est donc, avec l'océan Arctique au Nord, l'un des principaux moteurs du climat. Toutefois, les processus régissant la dynamique de l'océan Austral et ses interactions avec le climat sont complexes et encore mal compris. D'où la nécessité de mieux décrire cet environnement.
Prendre le pouls de l'océan Austral au sud de l'Afrique
Tel est le principal objectif de la campagne Bonus-Goodhope co-initiée par Sabrina Speich, enseignant-chercheur au Laboratoire de physique des océans et Marie Boyé, chargée de recherche CNRS au Laboratoire des sciences de l'environnement marin . Plus précisément, Bonus-Goodhope vise à mieux comprendre le fonctionnement physique et biogéochimique de l'océan Austral (échanges, cycles biogéochimiques, ventilation, trajet des masses d'eau). Pour cela, une foule de paramètres chimiques, géochimiques, biologiques et physiques ont été mesurés dans l'océan et l'atmosphère, au sud du continent africain. C'est la première fois qu'autant de paramètres sont acquis simultanément dans cette région du globe.
Bonus-Goodhope : une initiative française multidisciplinaire qui s'inscrit dans l'API
La campagne océanographique Bonus-GoodHope s'inscrit dans trois programmes-phare de l'API : GEOTRACES, ICED et CASO. Elle fédère 27 laboratoires et instituts internationaux provenant de 10 pays (France, Belgique, Allemagne, Espagne, Angleterre, Italie, Russie, Brésil, États-Unis et Afrique du Sud) et rassemble près de 70 océanographes. Portée par deux équipes françaises de recherche, elle est tout particulièrement soutenue en France par l'INSU-CNRS, l'IPEV, l'Ifremer et l'IRD. La première mission s'est déroulée du 8 février au 24 mars 2008, sur le Marion Dufresne, depuis Le Cap en Afrique du Sud jusqu'à la limite des glaces dans l'océan Austral. Les nombreux échantillons récoltés lors de ce voyage de cinq semaines sont actuellement analysés avant d'être interprétés. Une seconde mission océanographique, intitulée SACSO, sera menée en connexion avec le projet Bonus-Goodhope. Elle est prévue début 2010 dans la région du plateau continental située au large de l'Afrique du Sud.
Note(s)
- LPO, CNRS / IRD / Ifremer / Université de Bretagne occidentale
- LEMAR, CNRS / Université de Bretagne occidentale
En savoir plus
Contact
- Sabrina Speich, LPO/IUEM speich@univ-brest.fr, +33 2 98 01 65 11
![Terres australes et antarctiques françaises (TAAF).[...] Terres australes et antarctiques françaises (TAAF).[...]](/sites/institut_insu/files/styles/top_left/public/gallery_image/b2599_0.jpg?itok=Q73LQGgZ)